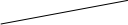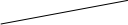Le crime de la Roche au Lion
Assassinat de Jeanne Campan
Suite
Le 17 août, le procureur de La Goublaye qui estime que le nombre des témoins est nettement
insuffisant, écrit aux Juges. Il leur expose, tout d'abord, les faits qui font ressortir la culpabilité de
Mathurin Boulé. Il haïssait sa femme et avait déclaré plusieurs fois qu'elle ne mourrait que de ses mains.
Il requiert de ces Messieurs « Acte de Remontrance » pour pouvoir faire publier un « Monitoire » et
en cas de besoin, un « Réagrave ». L'autorisation est accordée immédiatement.
De quoi s'agissait-il ? Le monitoire était une lettre envoyée, par l'Evêché, aux curés des paroisses
concernées, pour être lue en chaire, pendant trois dimanches consécutifs. Cette lettre mettait les
paroissiens en demeure de révéler ce qu'ils savaient sur l'affaire en question. Ils avaient huit jours pour
le faire, sous peine d'encourir les « censures de l 'Eglise ».
Le Réagrave, comme son nom l'indique, aggravait les effets du monitoire. Ceux qui, malgré les trois
lectures du « monitoire », persistaient dans leur refus de témoigner, étaient excommuniés.
Etre excommunié à l'époque était lourd de conséquences. L'excommunié se trouvait marginalisé par
rapport à l'ensemble de la population.
Le 17 août, le jour même où il avait été demandé, le monitoire est publié. Il est signé du Vicaire
Général. Les Recteurs de Lamballe, de Noyal et de Maroué le reçoivent avec ordre de le lire en chaire
à l'issue des grandes messes. Le Recteur de Landéhen, lui, ne reçoit rien, bien que sa paroisse soit toute
proche de celle de Maroué (quelques centaines de mètres seulement séparent les deux bourgs). Il y
avait à cela une raison bien simple : Landéhen, aussi bizarre que cela puisse paraître, dépendait de
I'Evêché de Dol. Le monitoire de l'Eglise produit un petit effet. Sept ou huit nouveaux témoins
viennent s'ajouter aux quatre premiers.
Le Procureur de La Goublaye estime, toutefois, que c'est insuffisant : Le 5 octobre, il fait publier le
Réagrave. Cette fois, c'est la sanction pure et simple pour ceux « qui refusent d'en venir à révélation
au mépris des monitions de I'Eglise et au péril de leurs âmes. »
Les témoins deviennent alors plus nombreux : Ils seront quatorze lors de l'audition du 8 novembre.
Pendant ce temps on a continué à rechercher mollement Mathurin Boulé.
Une troisième perquisition a été effectuée le 2 septembre au matin. Ce jour-là, à la même équipe qui
avait effectué les deux premières perquisitions, s'était adjoint François Le Box, le tambour ordinaire de
cette ville. En fait, plus que de chercher réellement Mathurin Boulé, il s'agissait de faire savoir aux
personnes qui avaient connaissance de l'endroit où il se cachait, qu'elles devaient, soit l'inciter à se
rendre, soit, tout simplement, le dénoncer. La petite troupe commence par se transporter sur la place
du Martray à Lamballe, au plus fort du marché. François Le Box bat la caisse et l'on attend quelques
instants afin que le peuple se rassemble. Par un cri public et intelligible, Joseph Régnier, l'huissier,
assigne alors Boulé à se présenter, sous huitaine, à l'audience de la Juridiction de Lamballe et à se
constituer prisonnier.
Ils recommencent la même cérémonie devant la porte principale de la Juridiction de Lamballe. La
petite troupe, au complet, se transporte ensuite à la Roche au Lion. La porte de la maison est encore
fermée et seul Julien Lemoine, le métayer, déambule dans la cour. L' huissier lui demande, une
nouvelle fois, s'il connaît l'accusé et s'il sait où il est. Il répond toujours négativement et refuse de
signer. Pour la forme, François Le Box bat la caisse et Joseph Régnier pousse son cri public et
intelligible... Une copie de l'acte d'assignation est fixée à la porte et tout le monde retourne à Lamballe
en laissant l'affiche sous la responsabilité du métayer. De retour à Lamballe, une affiche semblable est
placée sur la porte de la Juridiction. Maintenant tous ces braves gens vont pouvoir aller déjeuner, leur
travail est terminé, il est à peine midi.
Le 8 novembre, à huit heures du matin, Jean Nicolas Plancher du Bottier, sénéchal de la juridiction
de Lamballe, procède à l'audition des quatorze témoins qui se sont manifestés, avant ou après la
publication du Réagrave. Tous les témoins sont unanimes pour dire qu'ils n'ont aucune connaissance
ni de la cause, ni des auteurs de la mort de Jeanne Campan. Ils ont cependant tous entendu parler
de la mésentente qui régnait dans le ménage. Les Boulé avaient, un peu avant le drame, deux
servantes : Mathurine Gouret âgée de vingt-cinq ans et Marie Lhostelier qui avait alors dix sept ans.
Jeanne Campan avait confié à quelques unes de ses voisines que ces servantes étaient la cause de son
mauvais ménage... On imagine facilement la suite... Mathurin Boulé « faisait le Diable avec ses
servantes » dit Jeanne Lapie, un des témoins. Au cours de l'hiver qui précède la mort tragique de
Jeanne, Boulé a tiré sur elle un ou deux coups de fusil : l'intention de tuer était manifeste puisqu'il l'a
atteinte entre les deux épaules.
Michèle Besnard, la métayère de la Roche au Lion qui est beaucoup plus bavarde en novembre qu'au
moment du crime, explique qu'elle a trouvé les deux servantes occupées à panser le dos de leur
maîtresse avec des herbes pilées. Afin de « tirer le sang tué », dirent-elles. La métayère avait, sans
doute, été intriguée par le bruit de la détonation. Mais ça, elle ne le dit pas. L'affaire du coup de fusil
est connue de tout le monde. Jeanne Campan, elle-même, en avait parlé dans un premier temps puis,
se ravisant, elle avait demandé à ses confidents de garder le secret. Mathurine Gouret, la plus âgée
des servantes, qui veut, sans doute, essayer d'atténuer la responsabilité de son ancien maître, dit que
Mathurin Boulé avait déclaré que son fusil « était parti de repos » et qu'il allait le briser. Un autre
fait accablant ne laisse aucun doute sur la culpabilité de Boulé. Le dimanche des Rameaux précédant
la mort de Jeanne Campan, son mari a essayé de l'empoisonner et il a, sans aucun doute, bénéficié
pour cela de la complicité de Marie Lhostelier, la plus jeune des servantes. Ce soir là, on a servi à
Jeanne Campan une soupe faite de « lait marri » (il s'agit de lait caillé) dans laquelle on avait mis de
l'arsenic.
Louis Cherdo, fermier âgé de 47 à 48 ans va déposer « qu’il ne sait qui est l’auteur de la mort de la
dite Jeanne Campan, qu’elle lui dit un jour que son mari avait tiré sur elle et lui avait donné un coup
de fusil dans l’épaule et qu’il avait dit que son fusil s’en était allé le réparer, qu’elle lui a dit aussi qu’un
autre jour, elle avait mangé du lait marri qu’il lui avait fait mal et qu’elle avait été obligée de prendre
de l’orviétan (3) qu’ayant jeté de son reste à des poules elles en mangèrent et moururent . »
Jeanne Campan a mangé une partie de cette soupe et en a offert à Anne Gouret, sa voisine, qui se
trouvait là. Comme elles n'avaient pas tout mangé, Jeanne a donné le reste à ses cochons. Dans la
nuit, les deux femmes ont été si malades qu'elles ont cru en mourir. Les cochons de Jeanne Campan
et le chien d'Anne Gouret qui avaient mangé les vomissures de sa patronne, ont, eux aussi, été malades
et on a pu croire qu'ils allaient crever... Jeanne Campan s'était alors souvenue qu'elle avait remarqué,
dans le fond de son écuelle, quelque chose qui ressemblait à du gravier...
Tout le monde a plus ou moins entendu parler de l'histoire du poison et Mathurine Gouret ne semble
plus préoccupée d'innocenter son ancien maître. Elle raconte, qu'un jour, Boulé l'a envoyée lui chercher
une chemise dans son armoire. Elle a été très surprise, en prenant la chemise, de trouver, au milieu du
linge, un paquet d'arsenic... Elle n'a rien dit sur le coup, mais elle en a parlé à son confesseur qui lui a
conseillé de demander des explications à Mathurin Boulé. Quelque temps après, elle lui a posé la
question. Celui-ci a commencé par nier. Puis, se ravisant, il a reconnu qu'il s'était procuré de l'arsenic
dans le but de faire mourir des souris et des rats... Elle ne l'a pas cru car elle l'avait entendu dire, un
jour,
« qu'il allait porter malheur au Fouchu Normand de la Planche qui était le père de Jeanne Campan...»
Elle se souvient que, dans le même temps, trois cochons et trois poules moururent, sans raison
apparente, au Moulin de la Planche !
Depuis leur mariage, en 1741, les Boulé n'avaient eu qu'un seul enfant : Une petite fille, prénommée
Françoise Catherine qui était née le 6 février 1742. Cette petite fille mourut quelque temps avant le
drame... Louise Tarlet, un des témoins du 8 novembre, affirme qu'un jour, en sortant de la messe du
matin à Maroué, elle a entendu deux femmes qui disaient que Mathurin Boulé avait empoisonné sa
petite fille. Elle n'a pas vu, ou plutôt, elle ne veut pas dire qui étaient ces deux femmes.
L'accusation est grave et montre bien que, dans l'opinion publique, Mathurin Boulé avait une
réputation déplorable. Il est toutefois probable que cette accusation ait été uniquement le fait de la
calomnie car Mathurine Gouret, qui était bien placée pour voir ce qui se passait dans le ménage Boulé,
assure que la petite fille, lorsqu'elle est morte, était malade depuis plusieurs jours. Ce qui, à ses yeux,
semble éliminer la cause du poison. De nos jours, les choses seraient simples : On exhumerait le
cadavre et on ferait des analyses. En ce temps-là, on ne s'inquiétait pas pour si peu...
Les preuves étaient largement suffisantes pour condamner Mathurin Boulé.
Une déposition importante manquait pourtant : Celle de Marie Lhostelier, la jeune servante.
Assignation à comparaître lui fut faite, pour le quinze du dit mois de novembre. Il semble que cette
jeune fille de dix-sept à dix-huit ans était plutôt compromise dans cette affaire : Outre qu'elle s'était,
sans nul doute, livrée à la débauche avec le Maître de la Roche au Lion, elle était accusée d'avoir mis
l'arsenic dans la soupe au lait marri. Si elle ne s'était pas présentée, avec les autres témoins, le
8 novembre, c'est probablement parce qu'elle n'avait pas la conscience tout à fait tranquille.
Elle se présente, seule, le quinze novembre. Elle dit tout d'abord qu'elle est une parente éloignée de
Mathurin Boulé. Elle déclare ensuite qu'elle ne sait absolument pas qui sont les auteurs de la mort
de Jeanne Campan. Elle ajoute que, pendant les trois mois où elle a été employée chez les Boulé en
qualité de filandière, elle les a toujours vus en bonne intelligence !... En fait, elle ne veut rien dire et
elle ne dit rien. Il ne semble pas, malgré tout, qu'elle ait été autrement inquiétée pour cela. Les Juges
ont probablement pensé, avec raison, qu'elle avait souvent agi sous la contrainte lorsqu'elle était
« l'employée » de Mathurin Boulé. La Justice va maintenant laisser écouler quelques mois, pour voir si
des faits nouveaux se produisent...
Le 16 mars 1746, le sénéchal procède à une deuxième audition des témoins. Il réclame également des
chirurgiens, un deuxième procès-verbal. Tout cela n'apporte absolument rien de nouveau.
Le premier avril 1746, le Procureur de la Goublaye donne alors ses conclusions et prononce son
réquisitoire. Il demande que la contumace soit déclarée contre Mathurin Boulé :
accusé et fugitif. Il requiert que le dit Boulé soit condamné à être pendu et étranglé, jusqu'à ce que
mort s'en suive, à une potence qui sera dressée sur la Place du Martray, à Lamballe. Que l'accusé soit,
au préalable, soumis à la question ordinaire et extraordinaire (4) , afin d'avoir révélation de ses
complices. Que ses biens meubles soient confisqués au profit de la seigneurie de cette ville. Qu'une
somme de quinze livres soit prélevée, pour aumônes applicables à l'hôpital et pour faire prier Dieu
pour le repos de l'âme de Jeanne Campan. L'accusé étant fugitif, il suggère : « Que la sentence qui
interviendra, soit exécutée en effigie, dans un tableau qui sera attaché à la potence. »
Le 4 avril, le sénéchal prononce la sentence.
Il reprend, en gros, ce qui a été demandé par le procureur, mais il aggrave la peine : Après avoir été
soumis à la question ordinaire et extraordinaire Mathurin Boulé ne sera pas pendu.
Il est condamné « d'avoir les bras et jambes brisés et les reins rompus vifs, sur un échafaud qui, pour
ce dit effet, sera dressé sur la Place du Martray. Il sera mis, ensuite, sur une roue, la face tournée
vers le ciel, pour y finir ses jours. »
Comme on ne l'a toujours pas retrouvé, il sera exécuté en effigie !
Evidemment ! Mathurin Boulé était une crapule... La sentence était malgré tout terrible... Ainsi
agissait la Justice sous l'Ancien Régime! On ne se contentait pas de supprimer le délinquant, il fallait
qu'il meure dans d'atroces souffrances. Combien de malheureux sont morts dans des conditions
affreuses pour des peccadilles ? La mort de la pauvre Jeanne Campan avait été épouvantable !
On avait promis pire encore à son assassin mais, pour cela, il aurait fallu le prendre et on ne le
retrouva jamais... Il avait filé...
La mollesse avec laquelle avaient été faites les différentes perquisitions et les complicités dont il avait,
sans nul doute, bénéficié lui avaient permis de disparaître aisément. S'évanouir dans la nature était,
probablement, très facile à l'époque. On n'attachait, on l'a vu, aucune importance à l'identité des gens.
Il lui avait, sans doute, suffi de s'éloigner de quelques dizaines de lieues, de prendre un faux nom et de
ne pas faire parler de lui, pour échapper à la sanction qui pesait contre lui.
Les dernières années de Jean Campan, le vieux meunier de la Planche, avaient été perturbées par ce
drame qui, peut-être même, avait hâté sa fin.
Il disparaît moins d'un an après la conclusion du procès, à l'âge de quatre-vingt-deux ans.
Malgré cet âge avancé pour l'époque, on peut penser qu'il était resté bien valide et bien lucide jusqu'à
la fin de sa vie. C'est lui qui, le 12 août 1745, était allé, de grand matin prévenir la Justice de la
mort de sa fille : Pour faire cela, il lui avait fallu de bonnes jambes et des idées claires.
Vraisemblablement, à cette époque, il continuait d'être, au sein de sa famille, un patriarche
incontesté : son misérable gendre, on le sent, se méfiait du « Bigre de bonhomme de la Planche ».
Mathurin Boulé, lui avait pris le large. On le retrouve à Noyal sur Seiche (en Ille et Vilaine) à plus de
80 kilomètres de Maroué. Il s’est sans doute réfugié à Rennes, dans une grande ville, où personne ne
le connaissait. Il va refonder une famille avec Perrine Le Vilain et ce qui paraît étrange, c’est que sur
ses 5 enfants, son seul fils, Jean Mathurin, va faire le chemin en sens inverse pour refonder à son tour
une famille à Maroué. Elevé à Noyal sur Seiche, son père avait dû lui parler de ses origines. Pour
abandonner toute sa famille il devait avoir de bonnes raisons pour retourner si loin. A son mariage,
sa mère est absente et consentante. Ce Jean Mathurin Boulé aura, avec Jeanne Minguy, 7 enfants.
Notre assassin, quant à lui, décèdera à Noyal sur Seiche le 15 juin 1762 à l’âge de 41 ans.
Je suis allé voir le hameau de la Roche aux lions. Les maisons y sont coquettes et fort bien restaurées.
Voici quelques photos.
Est-ce que le fantôme de Jeanne Campan hante toujours les lieux ?
(4) La question ordinaire et extraordinaire : Dans l' étendue du parlement de Paris, on faisait usage de la question l'eau et
de celle dite des brodequins.
La question l'eau : La plus ou moins grande quantité d'eau qu'on faisait avaler à l'accusé formait seule la différence de la
question ordinaire ou extraordinaire. On faisait asseoir l'accusé sur une espèce de tabouret de pierre. On lui attachait les poignets
avec deux anneaux de fer, distants l'un de l'autre derrière son dos, puis les deux pieds avec deux autres anneaux qui tenaient
un autre mur. Devant lui, on tendait toutes les cordes avec force et lorsque le corps du patient commenait ne plus pouvoir
s' étendre, on lui passait un tréteau sous les reins, ensuite on tendait encore les cordes jusqu' ce que le corps fut bien en extension.
Le questionnaire, homme destiné par sa charge à cet ouvrage, tenait, d'une main, une corne de boeuf creuse, de l'autre, il versait
de l'eau dans la corne etf aisait avaler au patient 4 pintes pour la question ordinaire et 8 pintes pour l'extraordinaire. Un chirurgien
tenait le pouls du patient et faisait arrêter pour un instant, suivant qu'il le sentait faiblir. Pendant ces intervalles, on interrogeait
l'accusé pour en arracher l'aveu du crime dont il était prévenu ou pour avoir révélation de ses complices.
La question aux brodequins : Les brodequins se donnaient plus rarement que l'eau parce qu'ils pouvaient estropier l'accusé.
On le faisait asseoir, on lui attachait les bras, on lui faisait tenir les jambes plomb (d'aplomb), ensuite on plaçait des deux côtés
de chaque jambe, deux planches, une en dedans, l'autre en dehors. On les serrait contre la jambe en les liant sous le genou et au
dessus de la cheville du pied. Ensuite, ayant passé les jambes près l'une de l'autre, on les liait toutes deux ensemble avec de
pareilles cordes placées aux mêmes lieux. Alors on introduisait, avec force, des coins de bois dans les deux planches du dedans,
entre les genoux et par en bas, entre les deux pieds : ces coins serraient les planches de chaque jambe de façon à faire craquer les
os. La question ordinaire tait de 4 coins, l'extraordinaire de 8.
Dans le ressort de divers autres parlements, on employait pour donner la question, les mèches allumées entre les doigts.
On liait quelquefois le patient avec une corde par les bras renversés par derrière avec des poids aux pieds. On l' élevait en l'air
au moyen d'une poulie et après l'avoir laissé quelque temps suspendu, on le laissait tomber de toute la hauteur du lieu, demi pied
de terre avec des secousses qui disloquaient toutes les jointures et lui faisaient jeter des cris horribles.
" On employait aussi la question par le feu, la plus atroce peut-être de toutes et dont n'ont fait que trop fréquemment usage,
de nos jours, les scélérats nommés chauffeurs " .